Dans la même rubrique
Accueil :
- Recherche,
- Langues littératures et civilisations étrangères,
Subject properties in early modern Germanic languages: A contrastive corpus-based study
Pierre-Yves Modicom
Ouvrage paru à Berlin : De Gruyter, 2025.
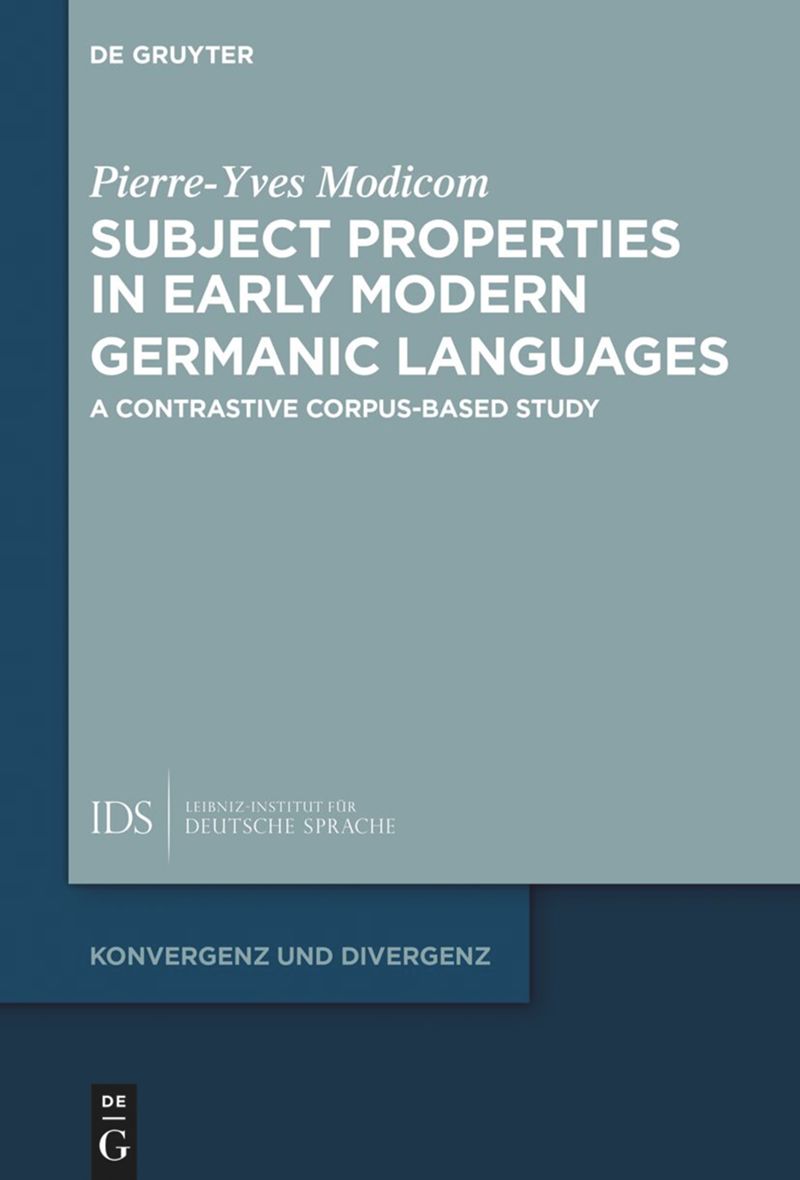
Pierre-Yves Modicom / Subject Properties in Early Modern Germanic Languages: A Contrastive Corpus-Based Study / Berlin : De Gruyter, 2025 / eBook EAN: 9783111544632 / Hardcover EAN: 9783111544137 / 375 p.
Pierre-Yves Modicom
DOI: 10.1515/9783111544632
De Gruyter, 2025
Le sujet est-il le point d’appui référentiel de toute prédication verbale, ou n’est-il au contraire que le primus inter pares des compléments ? Dans un cas comme dans l’autre, quels sont les critères qui permettent de catégoriser des syntagmes comme « sujets » dans des langues dont les propriétés formelles divergent fortement ? Cette fonction est-elle insensible au type formel de la langue ? Autant de questions classiques auxquelles se consacre cette monographie, en prenant pour objet quatre langues germaniques : l’allemand, langue dont les syntagmes nominaux portent une marque casuelle, où le verbe s’accorde avec le sujet, où l’ordre des mots est relativement flexible et où les verbes au passif peuvent se passer de sujet le néerlandais, le danois et l’anglais, où au moins une de ces propriétés fait défaut. Prenant appui sur la typologie de l’actance développée par Gilbert Lazard en l’adaptant aux avancées des grammaires de construction, l’étude se concentre sur une période charnière où ces quatre langues connaissent d’importants remaniements donnant naissance à leur syntaxe actuelle : la fin du 16e siècle. Pour ce faire, un corpus parallèle sert de fil conducteur. Il comprend l’original allemand de L’Histoire tragique du Docteur Faust (1587) et ses traductions danoise (1588), anglaise (1589 approx.) et néerlandaise (1592), tout en s’appuyant ponctuellement sur les connaissances acquises grâce à d’autres langues germaniques (islandais, yiddish) ou d’autres époques des mêmes langues. Les faits de langue analysés sont l’ellipse du sujet, sa reprise pronominale, le recours à des sujets formels, la typologie des explétifs, les passifs impersonnels et les sujets obliques.
L’étude repose sur la distinction de deux niveaux d’analyse empruntés à Lazard, un niveau ancré dans la structure informationnelle et prédicative, où le sujet est la grammaticalisation du topique, et un niveau valenciel où le sujet est le prime actant du verbe, cette prime actance pouvant être absolue ou relative. L’analyse permet de reprendre et de développer le concept de dissociation actancielle initialement posé par Lazard en l’intégrant dans un cadre constructionaliste. L’ouvrage propose ainsi une typologie des modes d’imbrication de ces différents niveaux d’analyse, de leurs intersections, et de leur convergence ou de leur divergence en diachronie.
>> Présentation et table sur le site de l'éditeur.
>> Résumé long sur le blog de l'auteur.
DOI: 10.1515/9783111544632
De Gruyter, 2025
Le sujet est-il le point d’appui référentiel de toute prédication verbale, ou n’est-il au contraire que le primus inter pares des compléments ? Dans un cas comme dans l’autre, quels sont les critères qui permettent de catégoriser des syntagmes comme « sujets » dans des langues dont les propriétés formelles divergent fortement ? Cette fonction est-elle insensible au type formel de la langue ? Autant de questions classiques auxquelles se consacre cette monographie, en prenant pour objet quatre langues germaniques : l’allemand, langue dont les syntagmes nominaux portent une marque casuelle, où le verbe s’accorde avec le sujet, où l’ordre des mots est relativement flexible et où les verbes au passif peuvent se passer de sujet le néerlandais, le danois et l’anglais, où au moins une de ces propriétés fait défaut. Prenant appui sur la typologie de l’actance développée par Gilbert Lazard en l’adaptant aux avancées des grammaires de construction, l’étude se concentre sur une période charnière où ces quatre langues connaissent d’importants remaniements donnant naissance à leur syntaxe actuelle : la fin du 16e siècle. Pour ce faire, un corpus parallèle sert de fil conducteur. Il comprend l’original allemand de L’Histoire tragique du Docteur Faust (1587) et ses traductions danoise (1588), anglaise (1589 approx.) et néerlandaise (1592), tout en s’appuyant ponctuellement sur les connaissances acquises grâce à d’autres langues germaniques (islandais, yiddish) ou d’autres époques des mêmes langues. Les faits de langue analysés sont l’ellipse du sujet, sa reprise pronominale, le recours à des sujets formels, la typologie des explétifs, les passifs impersonnels et les sujets obliques.
L’étude repose sur la distinction de deux niveaux d’analyse empruntés à Lazard, un niveau ancré dans la structure informationnelle et prédicative, où le sujet est la grammaticalisation du topique, et un niveau valenciel où le sujet est le prime actant du verbe, cette prime actance pouvant être absolue ou relative. L’analyse permet de reprendre et de développer le concept de dissociation actancielle initialement posé par Lazard en l’intégrant dans un cadre constructionaliste. L’ouvrage propose ainsi une typologie des modes d’imbrication de ces différents niveaux d’analyse, de leurs intersections, et de leur convergence ou de leur divergence en diachronie.
>> Présentation et table sur le site de l'éditeur.
>> Résumé long sur le blog de l'auteur.

